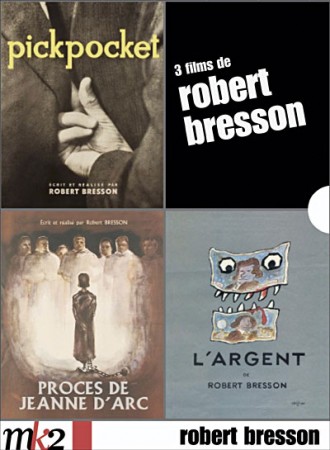 Tout le monde se souvient de cette fabuleuse réplique de Samuel Fuller définissant son art dans Pierrot le fou de Godard : « Un film, c’est comme un champ de bataille. C’est l’amour, la haine, l’action, la violence et la mort. En un mot, c’est l’émotion. ». Ce ne sont guère ces mots, soyons honnêtes, qui viennent spontanément à l’esprit lorsqu’on évoque le cinématographe de Robert Bresson et l’on accuserait l’auteur de ces lignes de se piquer en paradoxe forcé s’il disait que ces films sont parmi les plus captivants jamais faits. C’est pourtant ce que je pense. Un film de Bresson est, si l’on sait le regarder, une expérience unique de synesthésie, d’intensité et de passion. On peut en sortir en larmes, avec une âme, on peut même en sortir avec le sourire : la célèbre réplique « si ma mère me voyait ? » du Condamné à mort s’est échappé n’est-il pas le mot le plus drôle de l’histoire du cinéma ?
Tout le monde se souvient de cette fabuleuse réplique de Samuel Fuller définissant son art dans Pierrot le fou de Godard : « Un film, c’est comme un champ de bataille. C’est l’amour, la haine, l’action, la violence et la mort. En un mot, c’est l’émotion. ». Ce ne sont guère ces mots, soyons honnêtes, qui viennent spontanément à l’esprit lorsqu’on évoque le cinématographe de Robert Bresson et l’on accuserait l’auteur de ces lignes de se piquer en paradoxe forcé s’il disait que ces films sont parmi les plus captivants jamais faits. C’est pourtant ce que je pense. Un film de Bresson est, si l’on sait le regarder, une expérience unique de synesthésie, d’intensité et de passion. On peut en sortir en larmes, avec une âme, on peut même en sortir avec le sourire : la célèbre réplique « si ma mère me voyait ? » du Condamné à mort s’est échappé n’est-il pas le mot le plus drôle de l’histoire du cinéma ?
A l’occasion de la sortie DVD de cinq de ses chefs d’œuvres, une retraite s’imposait dans l’œuvre de ce maître absolu du septième art – et une bonne raison de relire Deleuze.
 Tactisignes.
Tactisignes.
La main a remplacé le visage. Elle a pour Bresson, une « existence autonome ». C’est elle qui conduit le jeu et qui opère les raccords.
« La main, écrit Deleuze, prend donc dans l’image un rôle qui déborde infiniment les exigences sensori-motrices de l’action, qui se substitue même au visage du point de vue des affections, et qui, du point de vue de la perception, devient le mode de construction d’un espace adéquat aux décisions de l’esprit. »[1]
Et en effet, c’est elle qui force à voler ou à tuer. Elle est le démon du corps bien plus que le sexe. D’ailleurs Michel, le « pickpocket » jouit de l’adresse et de la souplesse de ses doigts. Lui si mal à l’aise dans la vie, si décalé par rapport aux autres, si malheureux aussi, trouve sa voie et sa puissance dans le vol. «Je n’avais plus les pieds sur terre, je dominais le monde. » dit-il après sa première prise. Pour notre plaisir (eh oui ! Bresson donne du plaisir !) celles qui suivront seront de plus en plus spectaculaire. A l’instar de tous les livres et films de voleur (d’Arsène Lupin à Ocean’s eleven), Pickpocket nous procure ce bonheur coupable de suivre des êtres qui ont fait de leur corps une puissance ondoyante et invisible, qui peut toucher sans être touchée, qui fait fi des espaces et des volumes, qui s’insère et se retire dans les vêtements des autres, qui innove même dans le système des rapports d’objets. Le billet de banque qui dépasse d’un portefeuille et que l’on saisit avec un journal en retournant le journal avec le billet. Le journal que l’on glisse sous le bras de la femme quand celle-ci y remet son sac. Le portefeuille que l’on pique dans le veston du voyageur qui passe le long des compartiments et, après avoir pris l’argent, que l’on remet dans sa poche quand il repasse (plan qui fait immanquablement rire d’admiration le spectateur). Escamoter, interchanger, faire disparaître, laisser tomber, attraper au vol, et toujours avec ce regard d’anonyme, le pickpocket nous fascine car son art est un réenchantement du monde.
 Paroles
Paroles
La main est tout le corps, mais elle est aussi la parole de l’âme. Dans Procès de Jeanne d’Arc, lorsqu’on vient prévenir Jeanne, malade, allongée sur son lit, qu’elle n’aura pas les sacrements si elle ne révoque pas ce qu’elle a dit, sa main se lève et retombe sur sa poitrine, geste simple et émouvant qui signifie autant le découragement de la pucelle devant les hommes que son abnégation devant Dieu – et peut-être aussi cette tristesse qui a pris le Christ à Gethsémani. Entre elle et le moine qui l’aide de loin à répondre aux question de ses juges tout n’est qu’affaires de regards discrets et de signes de main. « Oui », « non », « ne réponds pas », « réponds », « bien » dit de la main ce clerc bienveillant (extraordinaire personnage et qui porte à son incandescence l’ « understatement » bressonnienne).
On connaît la technique de postsynchronisation propre à Bresson : au lieu de se revoir sur l’écran au moment où il doit dire sa réplique, l’acteur, que Bresson appelle son « modèle », est plongé dans l’obscurité et répète les mots que le metteur en scène lui souffle dans le casque ( !), recommençant vingt ou trente fois, le temps qu’il faut pour se désindividualiser complètement.
« Le modèle bressionien parle comme on écoute, dit Michel Chion, cité par Deleuze[2], en recueillant au fur et à mesure ce qu’il vient de dire en lui-même, si bien qu’il semble clore son discours au fur et à mesure qu’il l’émet, sans lui laisser la possibilité de résonner chez le partenaire ou le public ».
Ainsi est atteinte une littéralité de la voix qui, coupée de toute résonance directe, produit un discours indirect libre. La parole n’est donc plus chez Bresson une qualité individuelle, presque toujours théâtralisée, mais une image sonore à part entière qui exprime les mots du monde, de l’Histoire, de la légende.
 Espaces
Espaces
Cellules, prisons, gares, appartements parisiens.
Autant d’ « espaces déconnectés, dont les parties ne se raccordent pas, excèdent toute justification narrative ou plus généralement pragmatique, et viennent confirmer que l’image visuelle a une fonction lisible au-delà de sa fonction visible » écrit Deleuze[3].
Ce qui compte, ce n’est pas le décor, c’est le point de vue du personnage sur le décor. Pour le condamné à mort, la prison ne vaut et n’est vu que de l’angle qui permet de s’en évader. Pour le pickpocket, la gare n’est qu’un terrain de vol. La vue vole l’espace, se l’approprie, en fait un bloc de sensation singulière, ce que Deleuze appelle « une conjonction virtuelle ». L’espace, comme l’objet, n’existe plus en tant que tel, mais en tant qu’il affecte celui qui le subit ou le convoite.
Contrairement à Eisenstein, chez Bresson, ce n’est pas « la bouilloire qui a commencé » [encore que si comme dans Le Diable probablement où la bouilloire a "sa" scène] mais l’humain, le visage, les yeux, les mains. L’objet est vraiment objet de l’âme. Et l’espace est pour le voleur comme pour le prisonnier une question de temps : comment partir d’ici au plus vite (avant l’exécution), comment voler le plus efficacement et le plus rapidement ? C’est cette subjectivité qui est à l’origine de ce que l’on pourrait appeler le suspense bressonien et qui rend la vision de ses films si palpitante. Cinéaste spiritualiste sans aucun doute, mais ni introspectif, ni même intérieur, Bresson est aussi un raconteur d’ « actions ». Tout est mouvement vers l’extérieur, allées et venues (comme chez Dostoïevski où les personnages passent leur temps à aller les uns chez les autres), évasions, poursuites, voire « road movie » animalier (Au hasard Balthazar).
 Stations
Stations
Donc, un cinéma de l’être et non de l’individu.
On a dit que les acteurs bressoniens ne jouent pas. C’est vrai, mais ils sont - pures présences spirituelles, corps sans organes, âmes sans psychologie, visages sans esprit. On se souvient à vie de Martin Lassale, « le » Pickpocket, de Florence Delay et de Jean-Claude Fourneau, respectivement Jeanne et Cauchon dans Passion de Jeanne d’Arc, de Nadine Mortier dans Mouchette, de Christophe Patey dans L’argent. Et pourtant, de ces visages inoubliables, pas un n’a bénéficié de gros plan. La caméra filme généralement les corps pris entièrement et quand elle s’approche d’eux, ne s’aventure pas plus loin que le buste. Autant la main a pris la place du visage, autant le plan moyen a détrôné le gros plan. L’émotion est ailleurs.
« Bien que le gros plan extraie le visage (ou son équivalent) de toute coordonnée spatio-temporelle, il peut emporter avec soi un espace-temps qui lui est propre, un lambeau de vision, ciel, paysage ou fond (…) si l’affect se taille ainsi un espace, pourquoi ne pourrait-il pas le faire même sans visage et indépendamment du gros plan, indépendamment de toute référence au gros plan ? »[4]
C’est le miracle bressonien : ne plus avoir besoin de gros plan pour exprimer un affect. Un plan moyen, fragmenté, déconnecté, lui suffit. D’où cet impression d’éternité qui saisit chaque plan, celui-ci s’imposant à la fois comme la partie d’un tout (le film qui défile) mais aussi comme un tout singulier pour toujours. Alors que Dreyer faisait dans l’extatique (et de sa Passion de Jeanne d’Arc, une symphonie déchirante de gros plans), Bresson fait de chaque plan une station – comme on parle des stations du Calvaire. Pour autant, il ne cède à aucun ralentissement de rythme. Rien, dans ses films, ne se fige jamais. Contrairement à ce qui se passe chez Tarkovski, on pourrait dire que chez lui, l’éternité va vite.
 Liberté.
Liberté.
Chaque plan donne donc l’impression que tout recommence, mais non pas dans une dimension déterministe (le pickpocket va continuer de voler, Yvon va continuer de tuer) où tout est joué d’emblée mais au contraire dans une dimension existentielle de liberté absolue qui donne au héros la possibilité de recommencer son destin à chaque instant et comme il le souhaite. Dieu sait que nous sommes dans un univers du mal (du vol, de la corruption, de la sensualité, de l’injustice du destin, quand ce n’est pas de la méchanceté pure d’un personnage comme le Gérard d’Au hasard Balthazar qui provoque des accidents sur la route ou tourmente l’âne par simple sadisme[5]), mais autant cet univers est formellement et moralement défragmenté, autant ces fragments constituent des possibilités d’existence. Au fond, chaque condamné à mort que nous sommes peut s’évader de sa prison et se faire une nouvelle vie. Certes, comme le dit le commissaire de Pickpocket, quand on a commencé à mal faire, « on ne s’arrête pas », il n’empêche que Michel renoncera au vol pour l’amour qu’il porte à Jeanne (et même s’il doit passer son purgatoire en prison), et qu’Yvon, à la fin de L’argent, se dénoncera. Quant à Jeanne qui a eu un moment de doute et révoqué son témoignage, elle finit par révoquer sa révocation, prouvant son entière liberté et sa grâce retrouvée – Dieu ayant entendu sa prière sublime : « si je n’y suis, que Dieu m’y mette, et si j’y suis, que Dieu m’y tienne » [et dont un jour Stéphanie Hochet se souviendra.]
Etre libre, c’est choisir ce qui peut nous redonner tout à tout moment, c’est se donner la possibilité de se renouveler à chaque instant – à chaque station, c’est, selon la philosophie chrétienne, CHOISIR DE CHOISIR. Cinématographiquement, cela s’incarne à travers la grande guerre des formes.
« Nous partions d’un espace déterminé des états de choses, fait d’alternance blanc-noir-gris, blanc-noir-gris… Et nous disions : le blanc marque notre devoir, ou notre pouvoir ; le noir, notre impuissance, ou bien notre soif du mal ; le gris, notre incertitude, notre recherche ou notre indifférence. Et puis nous nous élevions jusqu’à l’alternative de l’esprit, nous avions à choisir entre des modes d’existence : les uns, blanc, noir ou gris, impliquaient que nous n’avions pas le choix (ou que nous n’avions plus le choix) ; mais seul un autre impliquait que nous choisissions de choisir, ou que nous avions conscience du choix. Pure lumière immanente ou spirituelle, au-delà du blanc, du noir et du gris. A peine cette lumière atteinte, elle nous redonne tout. Elle nous redonne le blanc, mais qui n’emprisonne plus la lumière ; elle nous redonne du coup le noir, qui n’est plus la cessation de la lumière ; elle nous rend même le gris, qui n’est plus l’incertitude ou la différence. »[6]
Quatre modes d’existence donc : le dévot ou comme le dit Deleuze « le redoutable homme du bien »[7], celui qui croit avoir choisi le bien (Cauchon dans Procès de Jeanne d’Arc, et d’une certaine façon les bourgeois de L’Argent) ; l’incertain ou l’indifférent, celui qui ne peut ou ne sait pas choisir (Michel, le pickpocket jusqu’à ce qu’il tombe amoureux de Jeanne – le premier titre de ce film étant d’ailleurs « Incertitudes ») ; le méchant ou « le terrible homme du mal » – celui qui a choisi le mal une fois et ne peut plus rien choisir d’autre (Gérard d’Au hasard Balthazar, ou bien la veilleuse des morts de Mouchette, figure satanique s’il en est, qui pousse Mouchette au suicide) ; enfin le croyant – celui qui choisit de choisir tout le temps (Jeanne qui revient sur sa parole mondaine et accepte d’être brûlée, Yvon qui se dénonce à la fin de L’Argent). Autrement dit, ne choisit réellement que celui qui est choisi par Dieu.
 Et celle qui ne peut choisir parce qu’elle est trop jeune et trop malheureuse pour le faire, Mouchette, Dieu la choisit aussi. Brisée par la vie, sans cesse rabaissée par les autres, Mouchette, en se donnant la mort, accomplit son seul acte libre et qui, dans son cas, sera remis par l’esprit saint - comme l’atteste le chant de joie du Magnificat de Monteverdi qui clôt ce film.
Et celle qui ne peut choisir parce qu’elle est trop jeune et trop malheureuse pour le faire, Mouchette, Dieu la choisit aussi. Brisée par la vie, sans cesse rabaissée par les autres, Mouchette, en se donnant la mort, accomplit son seul acte libre et qui, dans son cas, sera remis par l’esprit saint - comme l’atteste le chant de joie du Magnificat de Monteverdi qui clôt ce film.
Quant à Balthazar, autre symbole de l’innocence persécutée et incapable de se défendre, blessé par une balle d’homme, il meurt au milieu d’une clairière, entouré de moutons – rejoignant sans aucun doute « le paradis des ânes ». L’une des plus belles fins que nous ait données le cinéma à coup sûr.
C’est là le jansénisme modéré d’un auteur dont on s’est persuadé qu’il était d’un pessimisme total. En vérité, Bresson n’abandonne jamais l’espérance qui reste le clinamen de sa foi. Contre Rousseau et son homme qui naissait bon et devenait méchant à cause de la société, le chrétien Bresson pense au contraire que l’homme ne naît pas bon mais peut le devenir, quel que soit le « drôle de chemin » qu’il lui faudra prendre[8].
Coffret Robert Bresson (Pickpocket, Procès de Jeanne d’Arc, L’argent), MK2 éditions + Mouchette, Au hasard Balthazar, Arte vidéo.
(Cet article est paru dans Le journal de la culture n°15 de juillet-août 2005)
[1] Gilles Deleuze, L’image-temps, Editions de Minuit, page 22.
[2] Idem, page 315.
[3] L’image-mouvement, Gilles Deleuze, Editions de Minuit, page 28.
[4] Idem, page 153.
[5] Lui et sa bande de blousons noirs font terriblement penser à Orange mécanique de Kubrick, pourtant postérieur de neuf ans !
[6] Idem, page 164-165.
[7] L’image-temps, page 231.
